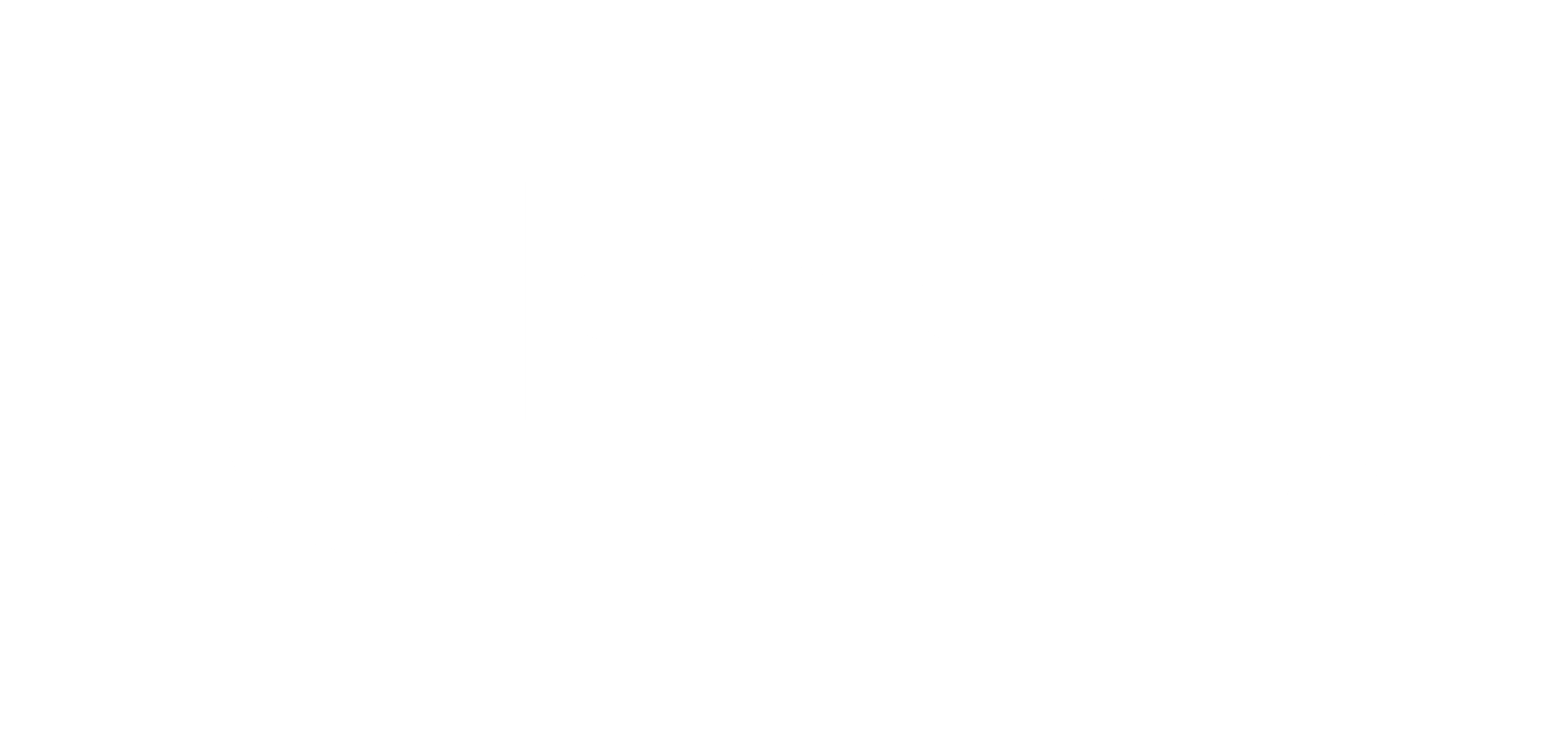Malgré l’absence de chiffres suisses dans le rapport TALIS 2024 ? Nous vous proposons un résumé des tendances les plus importantes qui ressortent du rapport produit par l’OCDE. Protéger le cœur du métier, muscler leadership et formation, mieux gérer la diversité, et encadrer l’IA sans naïveté. Une boussole pragmatique pour directions, enseignant·e·s et décideur·euse·s, du primaire au postobligatoire.
Ce résumé a été produit à l’aide de Claude AI et a été retravaillé par l’auteur
1) Introduction : objet et portée du rapport
Le rapport TALIS 2024 (Teaching and Learning International Survey) dresse un panorama international des conditions d’exercice du métier enseignant et du leadership pédagogique. Il interroge les enseignant·e·s sur les défis et directions sur leurs pratiques, leur bien-être, leur formation, leur charge de travail, leurs intentions de carrière et, nouveauté marquante, leurs usages des technologies et de l’intelligence artificielle. Le cadre analytique est celui des « Exigences ↔ Ressources » : la charge, la complexité des classes, la pression d’évaluation et la multiplication des réformes sont mises en regard de l’autonomie didactique, du soutien des pairs, de la qualité du leadership et de l’accès à une formation continue utile.
La Suisse n’a pas participé à cette édition, ce qui signifie qu’il n’existe pas de résultats chiffrés publiés pour ses établissements. L’intérêt du rapport, pour notre contexte, tient donc à la valeur de miroir qu’offrent les tendances robustes observées ailleurs : elles aident à hiérarchiser les priorités, tester la cohérence des politiques et repérer des leviers d’action qui s’adaptent bien à un système décentralisé et multilingue comme le nôtre.
2) Résultats transposables au système éducatif suisse
Satisfaction et variabilité intra-système. TALIS montre que la satisfaction professionnelle est globalement élevée, mais qu’elle varie fortement entre établissements d’un même pays. Ce constat parle à la Suisse : dans un fédéralisme éducatif où les cantons et même les écoles disposent de marges d’organisation, il faut regarder de près les écarts locaux. Un pilotage « au plus près » – diagnostics d’établissement, plans d’amélioration co-construits, partage de pratiques – est plus fécond que des prescriptions uniformes.
Charge de travail et cœur du métier. La charge administrative, la gestion d’incivilités et la succession rapide d’innovations ou de réformes figurent parmi les contraintes les plus pesantes. Transposé en Suisse, cela invite à protéger le temps d’enseignement, de préparation et de feedback, à simplifier les procédures, et à mieux séquencer les changements curriculaires ou évaluatifs pour éviter la « fatigue du changement ».
Diversité des élèves et différenciation. L’hétérogénéité linguistique, sociale et des besoins éducatifs particuliers accentue les exigences, mais ses effets sont modulés par la capacité à différencier et par la collaboration au sein des équipes. Pour la Suisse, c’est un plaidoyer pour des dispositifs robustes d’induction et de mentorat, l’essor de l’enseignement spécialisé en co-intervention, et la consolidation de communautés d’apprentissage professionnelles qui travaillent sur des problèmes concrets de classe.
Ressources humaines et développement professionnel. TALIS relie de façon constante la qualité perçue de l’enseignement et la satisfaction au sentiment d’efficacité personnelle, nourri par la formation continue « utile », l’observation croisée, le co-enseignement et un leadership pédagogique présent. Dans notre système, cela renforce l’idée de modules courts, contextualisés, adossés aux disciplines, avec accompagnement en situation et temps dédié.
Leadership et autonomie. Les écoles où la direction exerce un leadership pédagogique soutenant, donne de la clarté de cap et mobilise les équipes autour de priorités partagées, obtiennent de meilleurs résultats perçus et un meilleur climat. En Suisse, où l’autonomie est réelle, il s’agit de l’outiller : cadres de référence simples, espaces-temps de concertation, et pilotage par indicateurs compréhensibles par la profession.
3) Focus « IA » : enseignements pertinents pour la Suisse
Usages et besoins. TALIS documente des usages d’IA très divers : préparation de séquences, différenciation de supports, rétroactions rapides aux élèves, synthèse d’information, aide à la communication avec les familles, voire premières explorations d’analyses d’apprentissage. Les niveaux d’adoption varient selon les pays et les degrés scolaires, mais une constante se dégage : beaucoup d’enseignants déclarent un besoin de montée en compétences pour intégrer l’IA de manière responsable et efficace. Pour la Suisse, la priorité est double : construire une offre de formation pratique, ancrée dans les disciplines, et clarifier le cadre d’usage au niveau des établissements et des cantons.
Différences par degré. Dans plusieurs systèmes, l’IA est un peu moins utilisée au primaire, mais avec des bénéfices ciblés lorsqu’elle l’est : adaptation de la difficulté, supports multimodaux, communication simplifiée, appui aux besoins éducatifs particuliers. Au secondaire, l’usage s’étend davantage à la recherche, à l’écriture, aux sciences et au code, avec une sensibilité accrue aux enjeux d’intégrité académique. Traduction suisse : au primaire, viser des outils simples, supervisés et transparents ; au secondaire, renforcer la littératie informationnelle et la conception de tâches évaluatives plus authentiques (oraux, projets, journaux de production, situations de résolution).
Intégrité, biais et protection des données. Les craintes les plus fréquentes portent sur la facilitation de la triche, les biais des modèles et la confidentialité. Une politique réaliste pour la Suisse devrait articuler : des consignes d’établissement claires (ce qui est autorisé, ce qui doit être cité, ce qui est proscrit), des pratiques d’évaluation qui réduisent l’intérêt de la simple copie, une sensibilisation des élèves aux limites et aux biais, et une sélection d’outils compatible avec les exigences de protection des données. L’idée n’est pas de s’en remettre à des « détecteurs » peu fiables, mais d’éduquer à l’usage et de repenser certaines tâches.
Conditions de réussite. Les systèmes qui progressent combinent quatre ingrédients : une vision partagée (feuille de route et principes éthiques), des infrastructures interopérables (plateformes qui journalisent et permettent un pilotage responsable), une formation continue modulaire et « juste-à-temps », et un leadership pédagogique capable d’accompagner les équipes, d’évaluer les effets et de diffuser ce qui marche. Ces éléments sont compatibles avec la culture suisse d’amélioration par l’établissement et la mutualisation inter-cantonale.
4) Conclusion : priorités d’action pour la Suisse
Même sans données nationales TALIS 2024, les enseignements sont clairs et actionnables.
- Protéger le cœur du métier. Réduire la charge administrative, stabiliser le rythme des réformes, et sanctuariser le temps de préparation, de collaboration et de feedback.
- Investir dans la compétence professionnelle. Déployer des parcours de formation continue adossés aux disciplines, centrés sur la gestion de classe, la différenciation et l’usage éclairé du numérique et de l’IA, avec mentorat et accompagnement en classe.
- Piloter au niveau de l’établissement. Partir de diagnostics locaux (climat, besoins, ressources), fixer quelques priorités partagées, mesurer les effets, ajuster. Les principaux écarts se jouent à l’intérieur des systèmes : c’est là qu’il faut mettre l’énergie.
- Encadrer l’IA de façon pragmatique. Définir un cadre simple et cohérent (droits, données, transparence), clarifier les usages attendus et les règles d’intégrité, soutenir des outils utiles à la différenciation et aux rétroactions, et former élèves et enseignants à penser les biais et les limites.
- Renforcer le leadership pédagogique et la collaboration. Donner aux directions le temps et les moyens d’animer le travail collectif ; institutionnaliser l’observation croisée et les communautés d’apprentissage professionnelles ; reconnaître et diffuser les pratiques efficaces.
En somme, TALIS 2024 confirme un principe de base qui résonne avec la tradition suisse : équilibrer exigences et ressources, au plus près des classes. C’est en protégeant le temps et l’expertise des équipes, en outillant les directions et en encadrant intelligemment l’IA que l’on consolide à la fois le bien-être des enseignants, l’équité entre établissements et la réussite des élèves.
Le rapport complet est disponible sur le site de l’OCDE : https://www.oecd.org/en/publications/results-from-talis-2024_90df6235-en.html